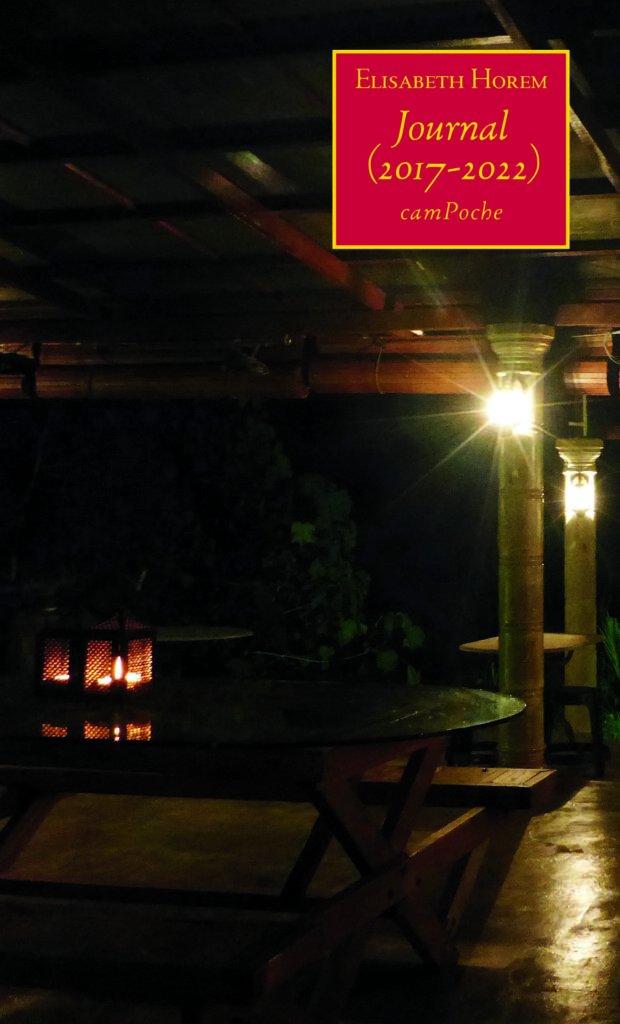(réalisée auprès de quelques écrivains suisses de langue française)
Patrick Amstutz, L’Aire (2001)
Les mots sont-ils vos alliés ?
La pierre est-elle l’alliée du sculpteur ? Les mots sont notre matière, il arrive qu’ils résistent ou se cachent comme un marbre ou un calcaire longtemps recherchés, mais ce terme d’« alliés » (alliés/ennemis) appliqué aux mots, cela n’a pour moi pas grand sens. Les mots sont en nous, c’est de nous qu’ils dépendent, ils sont ce que nous en faisons. (Quand je dis « nous », je parle aussi bien de nous lecteur que de nous écrivain, lire et écrire étant deux aspects d’un même mouvement de l’esprit.)
Je ne les considère pas non plus comme des outils. Leur rôle me paraît plus complexe et plus noble. Ils sont à la fois le but et le moyen.
Dire : « orage », « misaine » ou « bergamote » peut procurer un certain plaisir. Il y a une beauté des mots en eux-mêmes, une beauté trouble, chargée d’échos d’autres textes, d’autres souvenirs (aucun mot n’est jamais tout à fait seul), mais le pouvoir d’un mot isolé est limité. L’important, c’est ce qui circule entre les mots, c’est le souffle de la phrase, c’est ce qui n’est pas dit, ce qui palpite en marge du texte et que le lecteur attentif reconnaît. C’est ce qu’il y a au-delà des mots qui touche au plus profond, cet indicible vers lequel ils tendent. Proust écrivait : « Il n’y a que l’inexprimable, que ce qu’on croyait ne pas réussir à faire entrer dans un livre qui y reset… Cet inexprimable-là, quand nous ne l’avons pas ressenti, nous nous flattons que notre œuvre vaudra celle de ceux qui l’ont ressenti, puisque en somme les mots sont les mêmes. Seulement ce n’est pas dans les mots, ce n’est pas exprimé, c’est tout mêlé entre les mots. » C’est pourquoi la richesse des mots se situe surtout dans l’aura qui flotte autour d’eux (et ceci est valable pour les mots les plus ordinaires en apparence, tels que « pluie », « arbre », « mer » ou « chemin » – et même « être » et « avoir »).
La beauté d’un mot tient encore à son efficacité, à sa force, à la charge d’électricité qu’il contient, c’est son adéquation au frémissement qui l’a fait naître, sa proximité maximale de ce qu’on a cherché à traduire grâce à lui. C’est sans doute ce qui fait la beauté des termes employés dans certains métiers : ces mots-là ont été patinés par un long usage et par le besoin d’être rapide, efficace et précis. Les termes de la marine, par exemple, sont de bons pourvoyeurs d’images (Flaubert a relevé chez Ronsard ce précepte selon lequel le poète devrait s’instruire dans les arts et les métiers pour y puiser des métaphores).
Enfin, pour en revenir à ce terme d’« alliés », quand je dis que cela n’a pour moi pas grand sens, je me place évidemment du point de vue de qui essaie de faire œuvre d’art avec des mots. Mais je sais bien que les mots sont aussi utilitaires et qu’ils ne circulent pas que dans la littérature. Dans d’autres domaines que celui de l’art (comme l’information, la publicité ou le discours des politiciens) ce rapport de force avec les mots peut exister en effet. Les mots peuvent s’y révéler trompeurs et être les alliés de ceux qui trompent, la mauvaise foi peut jouer sur eux.
Quel rôle joue l’écrivain face au langage ?
D’abord celui de l’ouvrir en grand, de le déployer, de l’aérer en quelque sorte, un peu comme on aère des couvertures ! Le vocabulaire s’étiole et se fige, les mots s’endorment autour de nous, ils se raréfient. L’écrivain tâche de nager à contre-courant en s’occupant des mots pour qu’on ne les oublie pas, pour qu’ils restent vivants et gardent leur saveur. Je ne pense pas forcément aux mots rares ou compliqués. Les mots ordinaires ont autant besoin, sinon plus, d’être ravivés dans le mouvement d’un texte. L’usage prosaïque en a fait des mots-mercenaires, l’écrivain doit essayer de leur rendre leur dimension poétique, de faire vibrer autour d’eux des harmonies qui s’étaient tues.
Le mot vit par ce qui l’entoure. C’est une pièce de mosaïque dont on peut aimer la couleur mais qui ne prend sa signification et sa beauté que dans l’ensemble plus vaste de la phrase – comme la phrase prend les siennes dans l’ensemble du livre. L’écrivain est le mosaïste qui ordonne ses abacules pour les mettre en valeur les uns par les autres.
Un autre de ses rôles consiste à être à l’écoute des mots et de leur consonance – car un mot, même isolé, charrie dans ses syllabes une foule d’autres mots qui peuvent lui être associés, il renferme tout un réseau de correspondances. L’oreille joue un grand rôle dans le choix des mots et il est remarquable que lorsqu’on parle d’eux on en arrive assez vite à parler de musique. (Citons Flaubert : « Comment se fait-il que le mot le plus juste soit toujours aussi le plus musical ? ». Ou Gracq, quand il écrit que « même dans la prose, il faut que le son sache tenir tête au sens. » Il faut faire silence et écouter de toutes ses forces pour chercher le son le plus juste, celui qui soit le plus proche de cette vibration parfois infime qu’on a cru entendre à la fois en soi et hors de soi.
On pourrait encore dire que l’écrivain est un traducteur qui sait qu’aucun mot ne correspond vraiment à un autre mais ne fait que s’en approcher plus ou moins, qu’aucun mot ne peut rendre exactement et totalement compte du son original, de la note intérieure qu’il voudrait faire entendre à qui le lira. (Et le problème se pose : faut-il se limiter à des mots peu nombreux et choisis après mûre réflexion comme nous paraissant les plus chargés d’échos, ou bien les multiplier sans cesse, les accumuler, les corriger l’un par l’autre pour créer autant d’approches ? l’aspiration est la même, le choix de l’un ou de l’autre est peut-être affaire de tempérament.)
Les mots sont aussi des guides : il faut savoir les suivre, les écouter, car il nous dictent la suite, comme le potier infléchit la forme qui naît sous ses doigts et lui obéit dans le même temps (ce qui faisait dire à Gombrowicz que l’homme se caractérise par son incapacité à créer la totalité). Je pense qu’écrire exige avant tout de garder les sens en alerte, d’être, face au langage, aussi bien actif que réceptif – et de savoir perdre son temps. Beaucoup de temps.
Peut-on rêver d’une langue comme d’un amant ?
C’est une question idiote. À la rigueur si par ce terme de langue on entend le fait d’écrire – la rame de papier neuve, le stylo-plume et le cliquetis de son clavier d’ordinateur – alors là, oui, il arrive qu’on se précipite à sa table de travail avec une désir, une hâte et une joie qui peuvent se comparer à l’amour. Peut-être ai-je mal compris votre question mais, à mon avis, prétendre qu’on puisse rêver d’une langue (de la sienne qui plus est) alors que nous y sommes plongés et qu’elle nous baigne à chaque instant – et en rêver comme d’un amant de surcroît ! –, c’est une ineptie. Est-ce que vous rêvez de l’air que vous respirez, vous ?
Possède-t-on une langue ou est-ce elle qui nous possède ?
Peut-on jamais se vanter de posséder quelque chose, à part peut-être certains objets achetés à prix d’argent ? Par « posséder » une langue vous entendez sans doute la maîtriser, ce qui peut se dire à la rigueur d’une langue étrangère dans laquelle, après des années d’apprentissage, on s’exprime sans faire de fautes : le chemin parcouru a été si long, si ardu, qu’on mérite bien cette récompense de s’entendre dire qu’on « maîtrise » la langue en question (notre qualité d’étranger aventuré dans un monde inconnu nous donne droit à un peu d’indulgence). Pour ce qui est de notre langue, celle qu’on a balbutiée petit enfant et dans laquelle plus tard on écrit des livres, il en va autrement. Cette langue-là, on ne la « possède » jamais, quand bien même on connaîtrait par cœur les neuf volumes du Grand Robert, parce que les mots qu’on emploie dans une œuvre littéraire valent par leur consonance, par leur contexte toujours mouvant, palpitant, par les zones troubles qui sont à leurs confins – et ça c’est infini et, Dieu merci, fermé à toute possession.
Et ce mot de « posséder », dans quelle acception l’utilisez-vous au juste ? Le sens change selon qu’on possède quelque chose ou quelqu’un, si bien qu’entre les deux termes de la question il me semble y avoir un glissement de sens. « Posséder » : être propriétaire de quelque chose ? Tromper, duper quelqu’un ? Ou s’emparer de son corps et de son esprit – comme le démon possède ? J’avoue rester perplexe et ne pas voir clairement comment répondre à cette question.
Peut-on habiter une langue comme on habite un pays ?
Je n’aime pas trop ce terme d’« habiter », je sens que j’éprouve une méfiance instinctive en le rencontrant dans ce contexte. Il me fait penser à l’escargot dans sa coquille, il m’évoque quelqu’un d’« installé », un sédentaire définitif, voire propriétaire de la place (un peu comme votre « posséder » de la question précédente). La langue est mouvement, les mots sont des migrants, ils circulent et nous parmi eux. Les langues se traduisent, s’apprennent, s’influencent. Confrontés avec leurs équivalents (toujours approximatifs) dans d’autres langues, les mots gagnent une nouvelle dimension. (J’ai lu récemment chez Olivier Rolin cette réflexion intéressante qu’il n’est pas indifférent de savoir comment se dit « nuage » dans plusieurs langues étrangères.)
L’écrivain me paraît être un voyageur, pas forcément dans la vie qu’il a choisi de mener, mais dans son attitude. Le regard qu’il a sur le monde l’en sépare, en fait un étranger même s’il n’a jamais physiquement quitté son village. La langue est à l’image d’un vaste monde qu’il sillonnerait à pied. « Habiter » évoque un lieu fermé ou du moins délimité. La langue, s’il faut la comparer à un endroit qu’on habite, est une demeure mal close, poreuse à tous les vents. Mais je dirais plutôt qu’elle est elle-même le vent (ou l’eau), que c’est quelque chose en mouvement, insaisissable et irrésistible, un courant dans le sens duquel on nage.
S’il y a attachement à une terre et/ou à une langue partagée avec d’autres, cela n’existe-t-il pas une participation à la vie de la cité ? Comment dès lors se concrétise votre engagement de citoyenne ?
En ce qui me concerne, il faut d’abord préciser que je suis expatriée depuis une vingtaine d’années. Je ne retrouve que pendant les vacances (donc de façon superficielle et fragmentaire) mon pays d’origine, la France, mon premier pays, celui où j’ai appris ma langue, fait mes classes, reçu la formation qui devait m’amener un jour, plus tard, à écrire. La Suisse est devenue mon second pays quand j’ai épousé un Bernois (il y aura bientôt vingt ans de cela) et plus encore peut-être depuis que j’y ai été publiée, ce qui est désormais pour moi un lien très fort. Mais je n’y ai fait que des séjours tronqués (à Berne) pendant lesquels je me suis sentie isolée (je ne reviens pas sur les difficultés qu’il y a à apprendre le dialecte, même pour quelqu’un qui a étudié par ailleurs des langues réputées difficiles comme l’arabe ou le russe). La gentillesse des gens n’est pas en cause, mais, que je le veuille ou non, j’y suis toujours une étrangère, ayant d’autres habitudes et parlant une autre langue (ce qui prive entre autres de pouvoir jouer sur les mots et d’en rire). Ce n’est pas ma cité – à vrai dire je n’ai plus de cité, si j’en ai jamais eu. J’ai vécu avec bonheur au Moyen-Orient, à Moscou et maintenant à Prague, et il n’est bien sûr pas question de participer en quoi que ce soit à la vie de la cité dans ces pays hôtes.
Ensuite, « exiger », comme vous y allez ! Faut-il que parce qu’on écrit – pas d’activité moins sociale que l’écriture – il faille donner son avis sout toute chose ? L’écriture, en ce qui me concerne, n’est qu’une manifestation d’un certain goût de la retraite et du silence. Participer ou non à la vie politique est affaire de tempérament et me semble tout à fait indépendant du fait d’écrire. Même si j’étais fixée pour longtemps dans une ville que je puisse considérer comme mienne, je ne crois pas que j’y participerais véritablement à la vie de la cité, je l’avoue. D’ailleurs je ne pense pas que la voix d’un auteur quasiment inconnu se fasse mieux entendre que celle de n’importe quel autre citoyen qui s’engage dans la vie publique. Qu’on n’y voie aucune marque d’indifférence de ma part. Le fait même d’écrire révèle une sensibilité au monde, qui se manifeste différemment chez tel auteur ou tel autre. Flaubert « détestait le journal » mais y a-t-il une protestation plus émouvante contre l’esclavage et pour les droits de l’enfance que le bref récit qu’il fait dans une lettre à sa mère de cette scène où on lave une petite esclave noire en la savonnant avec du sable comme on le ferait avec une bête ?
Tant de gens à travers le monde sont privés de liberté et d’éducation, tant d’autres sont éduqués mais ne peuvent écrire ni être publiés – tant de femmes en particulier – qu’à mon sens la première façon de s’engager est de lutter contre cet état de choses en utilisant la liberté d’écrire dont nous jouissons. Que ceux qui, comme moi, ont la chance et le privilège de pouvoir écrire et être publiés – d’avoir l’occasion de répondre à une enquête dans un journal, par exemple –, que ceux-là se mettent à leur table de travail (d’autres se mettront à leur piano ou à leur chevalet ou à leurs études), que tous ceux qui peuvent le faire le fassent, aussi honnêtement que possible, avec tout le sérieux et la rigueur dont ils sont capables (grands et petits, ou même encore jamais publiés) pour qu’il y ait toujours des livres qui s’écrivent, nonobstant les dictatures et les intégrismes de tout poil.
(Prague, le 10 avril 1998)