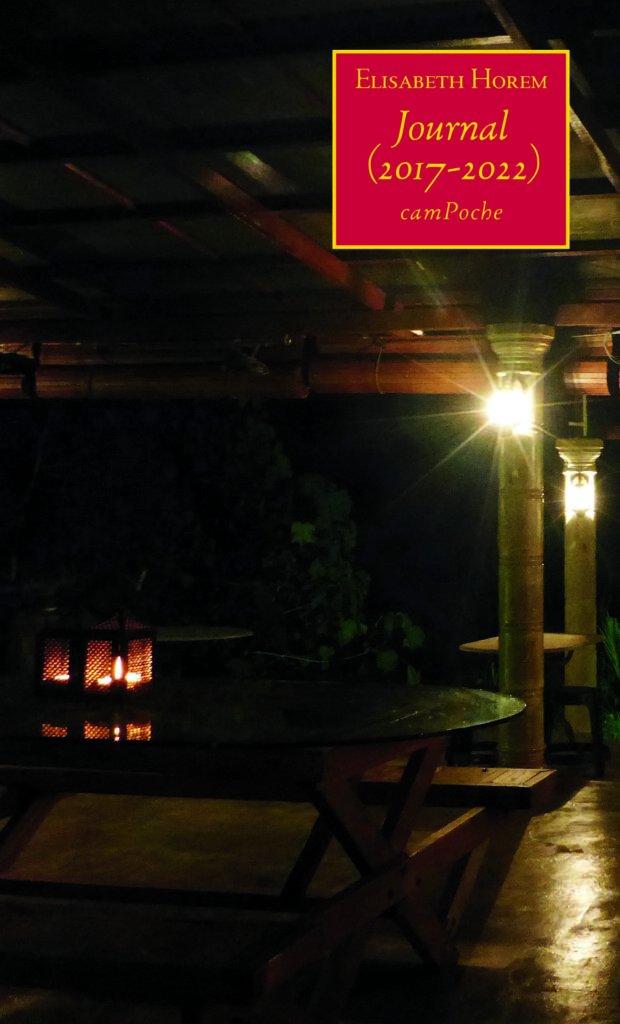Beyrouth de nuit était splendide. Toutes ces petites lumières accrochées aux flancs des hauteurs me rappelaient quelque chose de familier : le Qassioun, bien sûr. Pincement au cœur en pensant à Damas, là, juste derrière cette chaîne de montagnes enneigées. Longtemps nous avons vu les lumières de Beyrouth et de la côte, agglomération sans interruption. Sur la carte, entre Beyrouth et Tripoli, je repère Batroun (que j’ai mentionné dans La Mer des Ténèbres, à propos de Johann Ludwig Burckhardt). Pour la première fois nous avons pu nous asseoir dehors en plaçant nos fauteuils à l’abri du vent (nous les rentrons le soir dans la cabine). Il faisait doux, le clair de lune était éblouissant. Nuages ouateux gris-bleu, les ombres nettes sur le bateau, la lune reflétée dans l’eau et les lumières de la côte dont on s’éloignait peu à peu. Nous sommes rentrés vers onze heures, la côte syrienne devait être là, dans l’obscurité. Nous dormions quand nous sommes repassés près de Chypre. (13 janvier 2017)
_____
Vers midi, le détroit était au rendez-vous, la côte visible des deux côtés. À notre gauche, le Yémen, avec des plages blanches sous un relief assez doux, quelques constructions et des montagnes au fond. À droite, la côte érythréenne faisait une mince bande à l’horizon et derrière cette bande on voyait des montagnes. Le temps brumeux gênait la visibilité et le vent obligeait à se tenir derrière l’écran vitré près de la commande. Quelques nuages posaient des îles d’ombre sur la peau brillante de la mer sans couleur. Comme nous ne voulions pas faire attendre le steward, nous sommes descendus déjeuner rapidement et nous sommes vite remontés voir où nous en étions : les côtes avaient disparu, le détroit était derrière nous, la côte de Djibouti se cachait encore dans la brume. DJI-BOU-TI, ce nom m’évoque des sons plus que des images, tam-tam et bidons bringuebalants, bruit de choses qui s’emboutissent… (21 janvier 2017)
Le temps s’était radouci, j’avais plaisir à regarder la mer verte et moutonneuse sur laquelle nous allions nous élancer deux jours plus tard. Encore une fois j’ai admiré l’élégance de ces maisons, leur luxe, leur beauté, avec un peu d’irritation et de dégoût parce que je voyais toujours, comme en surimpression, des personnages noirs, misérables, kidnappés et entraînés loin de chez eux pour servir. La visite de la maison Edmondston-Alston se faisait sous la direction d’une dame très distinguée qui m’a dit d’un ton autoritaire de bien faire attention à ne rien casser avec mon sac à dos (pourtant petit et me tenant lieu de sac à main). Cela m’a inexplicablement contrariée, sans doute parce que je sentais en elle un certain dédain pour mon allure de campeuse (les autres visiteuses étaient pourvues de sacs de dame), mais j’étais surtout contrariée d’être contrariée. J’avais remarqué à La Nouvelle-Orléans que les maisons avaient une façade très étroite, correspondant à une seule pièce, et que le reste de la maison était tout en profondeur. Cette maison-ci (comme d’autres) présente la même caractéristique, sauf qu’elle a deux pièces en façade. Cette disposition permet d’utiliser le courant d’air qui passe le long de la galerie latérale d’où on voit la mer toute proche ; une lumière raffinée caresse les balustres blancs et les hauts volets verts des portes-fenêtres. Sobriété luxueuse, raffinement des couleurs. Aucune salle de réception ou de bal, il semble qu’on ne recevait que des amis. À l’arrière, un potager permettait à la famille d’être indépendante. Quatre ou cinq générations plus tard, le descendant du bishop qui a fait construire la maison en est le propriétaire et vit à l’étage. Portraits d’ancêtres, arbres généalogiques, cette aristocratie locale originaire d’Angleterre est un peu intimidante, mais les dessous de l’affaire – l’esclavage – me font l’effet d’un linge de corps sale sous un costume d’apparat. Je suis rentrée en prenant mon temps, le sentiment mitigé que j’avais eu pendant la visite persistait, ce malaise devant l’écart entre l’élégance inouïe, parfaite, l’harmonie d’un monde où tout est beau, l’image d’un paradis, et la souffrance tout aussi inouïe des esclaves qui ont construit ces maisons, fabriqué la richesse nécessaire à leur construction, à leur entretien et au train de vie mené par leurs maîtres. (14 novembre 2017, Charleston)
_____
Vers 16 h 30, hier, nous étions bien en face d’un port (il y avait une ville, des grues) mais ce n’était pas Anvers, dont nous étions encore loin. Le chenal dans l’estuaire n’en finissait pas. Bruit insolite de la grêle sur le toit. La lune est dans les nuages. On dépasse une ville éclairée, avec des clochers de brique et des usines, puis le bras de mer s’élargit, l’obscurité revient, le bateau suit le chenal balisé de rouge et de vert ; au loin, le halo d’autres lumières. On avance dans un monde féerique de raffineries, de damiers lumineux, de loin on dirait les immeubles d’une ville fantastique, c’est comme une illustration dans un livre pour enfants, mais ce ne sont que des usines, des raffineries surmontées de cheminées dont les fumées rougeoient, éclairées par les feux de signalisation pour les avions. Deux monstrueuses cheminées, comme deux ogresses noires (une centrale nucléaire ?), l’une des deux crache une épaisse fumée rougeâtre. Disséminées dans ce paysage surnaturel, de hautes éoliennes tournent. Et encore, au loin, le scintillement orange des portiques bardés de feux clignotants. Le port d’Anvers, quand on y arrive de nuit, est comme une immense cité. Ce qu’on pourrait prendre pour des immeubles ne sont que des installations, innombrables, toutes conçues pour obtenir un certain résultat, il n’y a rien de culturel là-dedans, tout n’est que technicité sans souci d’esthétique, mais le résultat, justement, pour un œil non averti, est d’une beauté à couper le souffle, comme si ces constructions, comme certains outils, finissaient par être belles d’avoir répondu exactement à un usage précis. (27 novembre 2017)
_____
En entreprenant d’écrire à nouveau mon journal, j’ai l’impression de renouer avec une ancienne habitude depuis longtemps rompue. Dehors, un jour jaune pâle se lève entre des bandes de gaze grise.
Je suis restée longtemps à l’écart de ces feuillets, tout en étant très proche de mon journal, publié en octobre. Je ne garde pas un bon souvenir de tous ces mois de travail acharné, démesuré, abrutissant, j’ai l’impression d’avoir été flouée d’une partie de ma vie. J’ai passé plusieurs mois de cette année 2018 devant mon écran d’ordinateur, y sacrifiant mes yeux et les beaux jours, mais je suis maintenant récompensée de ces mois de bagne. Les deux volumes de Feu de tout bois ont pris corps sous une couverture qui me plaît, les caractères sont agréables à lire. […]
Fatiguée par ce très gros effort, je n’avais plus écrit, gorgée de mots jusqu’à l’écœurement. Et puis, comme je l’avais pressenti et malgré les serments faits à moi-même de ne plus m’adonner à ce vice dévastateur (c’est ainsi qu’il m’apparaissait cet été), j’y retourne pour la première fois ce matin, et je sens revenir à pas de loup le besoin d’avoir un travail en cours.
Même à Moscou, en mai, je n’avais pas tenu mon journal, j’avais juste noté dans mon carnet mes impressions et ce que nous avions fait, notes que j’ai ensuite reprises pour en faire après coup un « journal », afin de garder la trace de ces retrouvailles avec Moscou. À cette occasion, j’ai compris qu’il faut écrire à chaud. Reprendre ces notes plus tard a été un véritable pensum. On ne m’y reprendra plus. » (19 décembre 2018)
____
Sur la place d’Octobre (qui ne s’appelle plus ainsi), nous sommes entrés dans un café d’où il était étrange de regarder la façade d’un immeuble maintenant pour nous étranger, anonyme, comme des milliers d’autres, et de savoir que nous avions vécu là quand nous avions la trentaine, dans deux appartements successifs. Le ciel avait cet éclat enthousiasmant et doux des jours de gel. La Moskova charriait des plaques de glace brisée qui brillaient au soleil. Nous avons pris la passerelle qui l’enjambe pour arriver dans la Frunzenskaïa. Les distances sont toujours plus grandes qu’on l’imagine, nous étions fourbus en arrivant chez Tolstoï. On a heureusement conservé la maison de bois peinte en ocre jaune, avec le tour des fenêtres en vert. Il faisait déjà nuit, nous voyions le domaine à la lumière des lampes. Derrière la maison, un assez grand jardin sous une épaisse couche de neige dans laquelle, sur le tracé des allées, on avait creusé des couloirs ; un kiosque, avec des fauteuils de rotin à l’intérieur, où il devait faire bon se tenir en été, à bavarder, lire et boire du thé. Un petit balai de bouleau est déposé à l’entrée pour faire tomber la neige de ses bottes et on met des patins de feutre pour visiter la maison. Dans la salle à manger, la table est mise pour une douzaine de personnes, service de porcelaine bleu et blanc, Sofia Andreïevna était assise à un bout de la table, tournant le dos à la fenêtre, et Lev Nikolaïevitch à l’autre bout. On ne servait du vin qu’aux invités. Adjacente à la salle à manger, la chambre à coucher, avec deux lits jumeaux qui paraissent étroits et courts, coincés derrière un paravent. Tout cela n’est pas bien grand. La table de toilette, avec un broc et des cuvettes de faïence. De l’autre côté du paravent, quelques fauteuils et un canapé pour recevoir les intimes. La chambre des garçons et celle de ce petit garçon malade, mort avant l’âge de sept ans, son petit lit en fer et celui de sa nounou. Des billards chinois. La salle d’étude et d’autres pièces que j’oublie, dans ce rez-de-chaussée où tout est simple et de modestes dimensions. Sur un couloir, que la famille avait surnommé « les catacombes », s’ouvrent les chambres des domestiques, peu différentes de celles des maîtres sinon par leur taille encore plus réduite. Le bureau de Tolstoï, où il a écrit nombre de ses livres. Il avait fait scier les pieds de sa chaise pour avoir le nez sur ses papiers (il était myope). Cette pièce de travail est assez grande, meublée de gros fauteuils de cuir noir pour recevoir les visiteurs. Dans un coin, un cabinet de toilette, un vélo, des haltères. Au bout du couloir, un réduit où on gardait la vaisselle et les pots de grès pour les légumes marinés. Un escalier mène à l’étage, qui était réservé aux réceptions. Dans le premier salon se trouve un piano à queue sous lequel est étendue une peau d’ours aux crocs menaçants. Un cordon de velours rouge barre l’accès aux autres pièces, chargées de tapis, de meubles plus précieux, des pièces plus colorées, plus sombres, où j’ai cru comprendre que Tolstoï ne venait guère, préférant un cadre plus sobre. Dans l’escalier, les enfants aimaient descendre en se laissant glisser sur un plateau de fer comme sur une luge, on imagine leurs cris et leurs rires. En 2016, cette maison de Tolstoï a été jumelée avec la maison de George Sand, à Nohant (sur des panneaux, dans le jardin, on peut voir son portrait et des photos de Nohant). (11 janvier 2019)
____
Le lendemain matin, nous embarquions à l’heure dite. Krasnoïarsk n’était déjà plus la ville que nous connaissions, sur le point de la quitter à bord d’un bateau je la voyais autrement. Le pont. La flèche de la gare fluviale dans le soleil d’un matin légèrement brumeux, doré. Nous trouver à bord de ce bateau qui semblait sorti d’un vieux film et marcher sur ce pont en bois où on pourrait donner des bals nous rendait euphoriques. Le haut-parleur du bord a diffusé une fanfare, comme si un orchestre était venu saluer le Valeri Tchkalov au moment où il se détachait du quai. Ont suivi, pendant quelques minutes, de ces musiques soviétiques fleurant la nostalgie d’une époque où il y avait peut-être, tout de même, des choses à regretter. Très vite il a commencé à faire froid à l’avant, dans le vent de la vitesse, il a fallu aller dans la cabine chercher des vêtements plus chauds. À 8h30 nous nous retrouvions tous dans la salle à manger pour un deuxième petit déjeuner avalé avec un appétit surprenant (assiette de kacha au beurre fondu et trois crêpes à la crème aigre). Cette cabine est à l’ancienne, avec des rideaux à ramages noir et blanc, le couvre-lit assorti, le voilage flotte doucement devant la fenêtre ouverte. On longe de près un escarpement couvert de mélèzes, il y a des rochers sur des pentes abruptes, herbeuses, des gens pique-niquent au bord de l’eau verte où se reflètent les arbres. De temps en temps, un bruit d’eau, comme le ploc d’un poisson, me fait lever la tête. Les balises continuent à défiler, cette numérotation a dû commencer à Krasnoïarsk. Un coup de corne : on vient de croiser un remorqueur de grumes. La rive est maintenant vallonnée, couverte d’une forêt dense de bouleaux et de mélèzes, la taïga, en un mot. Nous sommes en train de passer la bouée no 179. (8 août 2019)
_____
On entre dans Norilsk par la perspective Lénine bordée de hauts immeubles staliniens bleus et jaunes, avec la statue de Vladimir Ilitch à l’entrée. On avait voulu faire de Norilsk une seconde Saint-Pétersbourg, mais cela s’est arrêté à cette artère du centre. Devant le musée nous prenons à bord de notre bus une guide locale, Larissa, qui restera avec nous pour une heure. Son visage m’est connu : elle avait participé à ce documentaire que nous avions vu sur la Sibérie. […]
Nous avons traversé des zones indéfinies, sur des kilomètres, des terres écologiquement sinistrées, difficile de savoir si les installations qu’on y voit fonctionnent ou non. D’immenses usines sont abandonnées, désaffectées. Des installations rouillent sur place. Sur certaines on décèle toutefois des traces d’activité (c’est-à-dire de la fumée). Nous sommes d’abord allés au pied du mont Schmidt, là où tout a commencé. Au début des années vingt, les géologues se sont intéressés au sous-sol et y ont bâti ce qu’on appelle de nos jours la vieille ville – celle-ci maintenant à l’abandon et promise à un destin de ruine. Sur la pente dénudée du mont Schmidt a été érigé un mémorial en hommage aux milliers, aux dizaines, aux centaines de milliers de morts de faim, de froid, d’épuisement, tués par leur travail d’esclave. Il y a un peu de neige au sommet (ce lieu avait été choisi par les géologues pour y établir leur camp à cause de l’eau qui descendait du mont Schmidt). À l’entrée du mémorial il est d’usage, en passant sous le porche en bois, de faire sonner la cloche à l’aide d’une corde effilochée. C’est pour chaque visiteur une manière de rendre hommage aux victimes. Nous étions une vingtaine (nos deux groupes, le polonais et le russe), et cette cloche a sonné autant de fois dans le silence. Le monument polonais représente un double rail dressé vers le ciel et s’éparpillant en plusieurs croix de fer (tous ces gens étaient arrivés par le train). Il y a un monument balte, un monument juif, un catholique, un protestant, un monument japonais ; tous ces monuments ont été le fruit d’initiatives privées, et seulement à partir des années quatre-vingt-dix. De là-haut on a une vue d’ensemble sur la ville de Norilsk, c’est un champ de bataille, de désolation, de ruines et de rouille. Nornickel est maintenant aux mains de managers de notre temps, capitalistes aux dents longues ne se souciant que du chiffre d’affaires et certainement pas des gens ni de l’environnement. C’est précisément pourquoi on n’aime guère que des visiteurs étrangers viennent fourrer leur nez dans tous ces déchets. Larissa nous dit, et nous voulons bien la croire, que les gens de Norilsk sont attachés à leur ville, même si pour le bien de leurs enfants beaucoup cherchent à en partir. […] (19 août 2019)
_____
Notre première journée à Hiroshima était consacrée au souvenir de la Bombe – et il est étrange d’entendre annoncer dans le tram : «Next stop: Atomic Bomb. » On descend donc près du « Dôme de la bombe A», dernière ruine subsistant de l’explosion, qui s’était produite presque à la verticale de ce bâtiment. Sur les photos du désastre on le voit qui se dresse, solitaire, de même qu’un torii inexplicablement resté debout et quelques arbres calcinés. Tout le reste n’est qu’un champ de ruines. Une ville éradiquée. Sur ces photos on voit aussi des passants, des gens isolés, vivants, un homme à pied, un cycliste, deux jeunes femmes qui marchent, l’une sous une ombrelle, seuls au monde ; des gens qui étaient venus voir, parmi lesquels il y a eu des membres d’une commission d’enquête américaine, et je comprends seulement maintenant à quel point ceux qui ont lancé cette machine infernale en ignoraient la véritable nature et les horribles effets. Maintenant, nous les connaissons, une bombe a été lancée – deux bombes même –, les Japonais ont fait les frais de ce test, et nous savons donc très bien de quoi il s’agit, mais ces outils de pouvoir, édulcorés par la fable qu’ils seraient une garantie de paix, on les fabrique toujours, et bien des dirigeants seraient prêts à se damner pour en doter leur pays. […] Il y a eu des controverses au sujet du Dôme : fallait-il le conserver pour qu’il continue à témoigner ou le raser pour effacer cette cicatrice sur le visage de la ville? On l’a conservé et c’est heureux, la ville aurait sinon perdu une dimension essentielle. Quant aux cicatrices, elles ne manquent pas. On dépasse le Dôme, on franchit le pont pour arriver sur l’île où se trouve le Peace Memorial Park, on recherche l’ombre. Des groupes d’écoliers un peu partout, en uniforme. Au milieu du parc, une arche basse de granit poli abrite le cénotaphe des victimes de la Bombe. Le Dôme se trouve dans l’alignement de l’Arche et du musée. Une flamme est entretenue près de l’Arche en permanence. Des fleurs ont été déposées. Des gens en prière, debout, recueillis. Le Mémorial de la Paix a été construit près de là, à l’épicentre de l’explosion. Les jets d’eau d’une fontaine, symbole d’apaisement – et plus particulièrement de l’apaisement de l’horrible soif qui a torturé les victimes. On descend en spirale par une rampe faiblement pentue jusqu’à une salle circulaire dont le mur est recouvert d’une mosaïque dont chaque pièce représente une victime, leur assemblage reproduisant la photo, sur 360°, de la ville d’Hiroshima après l’explosion. La visite du Musée comprend deux parties. La première consiste en la présentation de témoignages, de photos, d’objets : horloges arrêtées, tordues, vêtements en loques souillés par cette pluie noire que les gens buvaient, le visage tourné vers le ciel, la bouche grande ouverte pour étancher leur soif – une pluie mortelle. Des photos montrent ce qu’on a appelé « les ombres d’Hiroshima » : les radiations ont décoloré la pierre, et quand quelqu’un était assis sur une marche ou debout devant un mur, son corps a fait écran aux radiations de telle sorte que la teinte d’origine, plus sombre, est restée dessinée comme l’ombre de ces corps. Des témoignages multiples d’enfants, de parents, de vieillards, tous déchirants, racontant tous la même histoire, répétitifs et terribles par cela même. […] (6 septembre 2019)
________
Hier matin à onze heures, Hartmut sonnait à notre porte et nous nous sommes mis en route pour la Nouvelle Capitale. Le taxi longe la Corniche, par Garden City. L’hôtel Méridien est toujours désaffecté, couleur de poussière sur toute la façade. On ne peut s’empêcher de regretter la magnifique terrasse sur le Nil où il était si agréable de boire un verre. Pendant que le chauffeur fait le plein, nous achetons sur son conseil de l’eau et des sandwiches, car nous risquons de ne rien trouver dans la Nouvelle Capitale. Tant qu’on est encore en ville, la circulation est très dense. Maadi n’est pas qu’un quartier vert et résidentiel avec des villas et des jardins où vivent les étrangers, comme dans le souvenir que j’en avais gardé, c’est devenu une véritable ville, très étendue, avec des immeubles dont beaucoup sont de guingois, bâtis à la va-vite, leurs balcons encombrés d’objets et de linge mis à sécher. L’impression de surpeuplement se prolonge sur des kilomètres bien au-delà du centre du Caire. On finit par sortir de l’agglomération par des autoroutes à quatre ou cinq voies, neuves et vides tout à coup. On a prévu grand, mais il faut bien cela si on prend au sérieux les projets lancés. On se trouve maintenant dans le désert, un vrai désert de sable et de caillasse où on voit des pâtés d’immeubles encore inachevés, serrés les uns contre les autres, au milieu de rien. Des bretelles d’autoroute, où des panneaux annoncent des noms de ville, tels que « Mostaqbal City» – partout l’influence de l’américain vient se glisser dans la langue. De loin en loin, la masse trapue de mosquées flanquées de minarets. La cathédrale, énorme et solitaire, financée par un milliardaire copte. Ce qui frappe, c’est que tout cela, qui est encore peu de chose, est incroyablement disséminé dans le désert. Plutôt que de commencer par une sorte de centre à partir duquel une ville pourrait se développer, on a construit quelques points (encore en chantier) à des kilomètres de distance les uns des autres. Comment combler ce vide entre eux ? On arrive enfin à ce qui semble être le cœur de la Nouvelle Capitale – ou de son projet –, la seule réalisation achevée et en fonction : un centre de congrès et un hôtel. Notre chauffeur n’était pas du tout à l’aise dans cette zone où n’étaient visibles que les forces de sécurité à l’entrée. On lui demande ses papiers, un chien vient flairer la voiture. À nous, on ne demande rien. Nous entrons dans l’enceinte par la porte no 1. Nous descendons de voiture pour entrer dans l’hôtel Al-Masa, et lui va se garer un peu plus loin après nous avoir fait promettre de ne pas nous attarder. C’est un immense hôtel très luxueux, tout de marbre. Deux ou trois gars sont à la réception, un homme avec une valise attend dans le lobby. Une salle de restaurant en contrebas (déserte) donne sur un bassin d’eau bleue, c’est le château de la Belle au bois dormant. Ils ont fait, pour commencer, le plus facile à faire n’importe où : un hôtel. Mais une ville ? L’eau, dit-on, sera amenée à la surface, en creusant profond. J’ai entendu aussi que l’eau serait amenée du Nil, ou peut-être de la mer Rouge, désalinisée. Des segments de canalisation de quelques mètres de diamètre me rappellent la Rivière artificielle en Libye. Devant l’hôtel, une maigre pelouse est irriguée par un réseau de tuyaux de caoutchouc noir comme on en voit partout à Doha. J’avais impression d’être dans le Golfe – la richesse en moins. Une rangée de drapeaux serrés claquent au vent, tous de pays arabes ou musulmans, et sur le fronton de l’entrée flotte le drapeau égyptien agrémenté dans son coin supérieur des sabres croisés saoudiens, comme une manière d’allégeance au royaume wahhabite. Hartmut avait fait quelques pas pour se dégourdir les jambes et était hors de vue, notre chauffeur était nerveux, nous disant qu’il était interdit d’aller de ce côté. Il semblait très soulagé de repartir, demandant sans cesse sa route à des camionneurs. Plusieurs fois à l’aller, il avait dépassé l’embranchement à prendre, pourtant indiqué, et je me suis demandé s’il savait lire (mais peut-on obtenir un permis de conduire sans savoir lire ?). Nous avons repris la direction du Caire par une route parallèle à celle que nous avions prise pour venir. Notre chauffeur était visiblement soulagé de quitter cette zone étrange, absurde, pas tout à fait réelle. Sur cette route-ci, un peu de circulation tout de même, surtout des camions. On longe d’interminables murs d’enceinte, ponctués de miradors en béton. De loin en loin, de gigantesques portes de style pharaonique marquent l’entrée dans des espaces qui ne comportent qu’une zone construite au milieu – pour le reste, c’est de la caillasse. De faux palmiers camouflent des antennes de téléphonie. Puis, de nouveau, Maadi et la corniche, nous retrouvons la vie. Zamalek paraît un véritable paradis, comparé à cette Nouvelle Capitale. Cet aller et retour, qui nous aura pris quatre heures, nous a confirmé ce que nous devinions : cette capitale n’existe encore que sur le papier, sur les images virtuelles et dans les rêves du président Sissi. Les chiffres donnent le vertige et laissent sceptique : 6,5 millions d’habitants, 1 750 000 emplois, des jardins plus vastes que Central Park, des parcs d’attractions grands comme plusieurs Disneyland, etc. Les 45 milliards de travaux prévus initialement ont été revus à la hausse. J’imagine mal des ambassades se déplacer dans ce désert. Un mirage ? Nous revenons de cette visite critiques, incrédules et attristés, car dans ce projet, le petit peuple égyptien qui a tant de mal à vivre n’est nullement pris en compte. (6 février 2020)
______
De l’orage d’hier soir il ne reste aucune fraîcheur. Hier était une journée de repos pour M. Il avait rapporté son violoncelle à la maison pour travailler quelques passages difficiles. […] Il faisait encore très chaud dans les rues, à quoi s’ajoutait la torpeur du dimanche. Un peu partout, des canettes et des bouteilles vides roulées à terre, des ordures, des traces d’urine ou de vomissures, le défoulement du samedi soir avait laissé des vestiges qui, le dimanche, ne sont pas nettoyés. Arrivés au Danube, nous avions en face de nous la masse du château. Il faisait lourd, orageux, un soleil blanc se reflétait à la surface de l’eau. […] Il y a là, au bord du Danube, un monument émouvant, si toutefois le mot de monument peut ici s’appliquer : des chaussures en bronze, par paires ou dépareillées, des escarpins de femme à talons, de gros godillots d’homme, des chaussures d’enfants, toutes ces chaussures scellées à la pierre du quai, tout au bord. Elles sont là pour rappeler de façon saisissante l’assassinat de vingt mille juifs, à cet endroit même, par les Croix-Fléchées, chiens dociles des nazis, qui les amenaient là, les tuaient et poussaient leurs corps dans les eaux du Danube. Trois sobres plaques commémoratives le rappellent, en anglais, en hongrois et en hébreu […] (9 août 2021)
Dernier jour à Budapest. Vers quatre heures hier après-midi, j’ai dû me faire violence pour affronter la chaleur et aller voir le musée Franz Liszt. Encore une fois, la rue Kazinczy, la synagogue, les restaurants (dont beaucoup de restaurants juifs). Une fraîcheur de cave venait me caresser quand je passais devant la porte ouverte d’un bar climatisé, je ralentissais le pas. De temps en temps, je recevais une goutte : la condensation d’un climatiseur faisait une flaque sur le trottoir. Le musée Ferenc Liszt est au premier étage du 35 de la rue Vörösmarty, presque au coin de l’avenue Andrássy, dans un appartement du XIXe siècle qui me rappelait d’autres maisons d’écrivains ou de compositeurs, celle de Tolstoï, par exemple. Des orgues et des pianos de toutes tailles et, créé pour Liszt par Bösendorfer, un bureau de composition muni d’un clavier de trois octaves. […] Et je songeais qu’à quelques dizaines de mètres de là se trouvait, de l’autre côté de l’avenue Andrássy, au no 60, la maison où un peu plus d’un demi-siècle plus tard on avait torturé, épouvanté, assassiné avec sauvagerie. Face à face, ces deux lieux symbolisaient l’un la culture la plus raffinée, l’art et tout ce dont l’humanité peut être fière, et l’autre, l’abaissement le plus abject. (13 août 2021)
_____
Depuis la dernière fois que j’ai écrit ici, j’ai continué à mettre au net mon journal – et cette phrase que je viens d’écrire se trouve à plusieurs reprises mot pour mot dans le journal de 2017 que je suis en train de corriger. J’en suis arrivée à ma traversée du Pacifique sur le Cap Capricorn, c’est un souvenir que je ne peux partager avec M., et je n’en parle donc jamais. Reprendre mes notes de cette traversée est une redécouverte. Pour un lecteur, les récits de séjour sont peut-être plus intéressants parce qu’un séjour est une tranche de vie, on y est impliqué, on y laisse quelque chose de sa personne. C’est aussi le cas pour les voyages itinérants mais cela prend une autre forme. On cueille au passage ce qui nous modifiera, une fois rentré à l’étable on rumine l’herbe arrachée au bord du chemin, et cela prendra un peu de temps pour faire vraiment siennes toutes ces impressions reçues. Il va sans dire que l’écriture est pour moi le complément naturel de ce type de voyage. Quand il s’agit de publier son journal, on se trouve face à deux forces contraires qui tirent le texte à hue et à dia. D’une part, le journal d’un voyage est écrit pour ne rien oublier, et je vois que cette tendance se renforce chez moi avec les années, avec la peur que s’effacent les souvenirs des lieux et des visages, on en écrit le plus possible, aucun détail ne doit être négligé, chacun susceptible d’aider à se souvenir ensuite. D’autre part, la mise par écrit en vue d’une publication adressée à un lecteur qui n’a pas fait ces voyages, n’est pas allé à Java, n’a jamais pris de cargo, exige l’opération inverse. Il faut retirer tous les détails qui n’avaient été notés que pour mon usage personnel. Quand je dis que je corrige mon journal, je veux dire que je le débarrasse de tout ce qui l’encombrait pour qu’il en sorte propre, rasé de près, nuque dégagée. (10 juin 2022)
_____
Ce territoire qu’on nous octroie pour « des déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile » et que d’aucuns jugent exigu, ce territoire est en fait trop vaste pour que je puisse l’épuiser – bien plus vaste que la place Saint-Sulpice. Il se passe toujours quelque chose ailleurs que dans la rue où je suis en train de marcher, et dans cette même rue, où je ne marcherai pas demain, occupée à explorer de nouveaux domaines, il se passera, demain, toutes sortes d’événements qui peuvent sembler infimes mais n’en sont pas moins des événements, or ces événements-là, je n’y assisterai pas, je ne pourrai pas les noter ici, ils seront irrémédiablement perdus. Cette tentative d’épuisement d’un cercle de 3,14 km2, quinocéen et non parisien, est donc, dès le début, vouée à l’échec. Mais puisque les autorités nous ont accordé une heure quotidienne de promenade, pas question de ne pas utiliser ce temps – et tout cet espace, pensez donc : un kilomètre tout autour de chez vous, avec ou sans chien. Je m’en vais donc explorer ce royaume licite comme un voyageur curieux. Pour tout bagage, mon carnet. Aujourd’hui, un temps idéal : bien gris, bien terne – le temps qu’il doit faire un 11 novembre –, mais sans pluie ni vent, ni froid excessif. Par où commencer ? Nos promenades, d’habitude, nous entraînent vers le port, c’est-à-dire vers la mer qui toujours attire comme un aimant. Alors, cette fois-ci, pour cette première expédition, je ne me suis pas souciée de la mer et j’ai exploré les rues les plus proches, mal connues de moi. On s’intéresse toujours au lointain, à ce vers quoi on se met en route, puis on rentre, et voilà, c’est déjà le coin où on tourne à droite, puis ce sera encore à droite et nous serons chez nous, et à partir de ce coin où on tourne à droite on ne regarde plus rien, on est déjà rentré à la maison, en pensée les pieds sur les chenets, même si comme moi on n’a ni cheminée ni chenets. J’ai descendu le bout de notre rue qui tombe à angle droit sur la rue des Cerisiers. La rue des Korrigans (où nous habitons au no 3) n’est pas une rue mais une impasse, c’est ce qui m’a retenue d’en monter les quelque trois cents mètres après notre maison, des voisins auraient pu trouver étrange que je marche devant chez eux en prenant des notes. Je sais plus ou moins ce qu’il y a là-haut, enfin, je crois le savoir pour y avoir parfois fait demi-tour. Je sais qu’une allée privée continue encore entre quelques maisons et qu’il y a là un gîte. En saison, on entend rire des gens qui passent en portant leur natte et leur sac de plage. On entend aussi parfois des chevaux hennir : il y a une pâture au bout de la rue avec quelques gros chevaux campagnards. Notre impasse s’appelle « rue » sans doute parce qu’il y a, juste après notre maison, une véritable impasse, très courte, qui dessert tout juste trois maisons et qui s’appelle « impasse des Korrigans ». Je devrais aussi parler des maisons immédiatement voisines de la nôtre, mais je n’en sortirais pas, je n’ai même pas commencé le récit de cette première séance de tentative d’épuisement du kilomètre autour de chez moi. Allons-y. (« Tentative d’épuisement d’un lieu quinocéen. 3,14 km2, 60 minutes » – Première promenade, 11 novembre 2020, pp. 929-930)