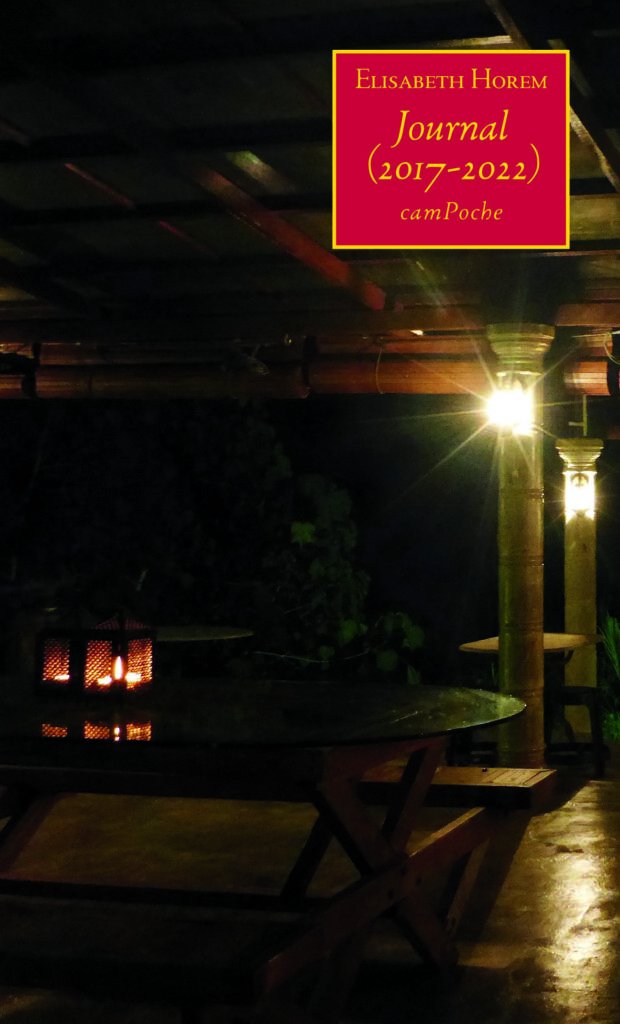23 mai 2006, à Amman
Hier nous avons passé notre dernière soirée dans le jardin, tous les deux – et quelques hommes discrets ici ou là, bien sûr, puisque nous ne sommes jamais seuls. J’avais encore fait quelques adieux. À Hosni le jardinier. Aux gardes, ceux de la journée puis ceux du soir. Le pauvre A**, d’habitude si prompt à rire, pleurait à chaudes larmes. Khalil, pas loin de pleurer non plus. Nous avons passé une belle soirée, difficile de se mettre dans la tête que c’était la dernière, les petits chats batifolant dans l’herbe et se dire qu’on ne les verra pas grandir, regarder comme d’habitude les lézards sur les murs, les hélicoptères, ces drôles d’oiseaux auxquels on s’était habitué, les chauves-souris qui tournent au-dessus du jardin et les moustiques qui attaquent, ponctuels, tous les soirs à heure fixe. Ce matin à quatre heures j’étais réveillée. Vers cinq heures, quand le jour a commencé à poindre, je me suis levée et j’ai fait le tour de la maison, essayant de retrouver mes impressions du tout début, me disant Cela fait deux ans et huit mois, et j’avais beau tourner cette phrase dans ma tête elle restait une combinaison incompréhensible de mots vides de sens. La chambre où nous avons dormi au début. J’ai regardé par la fenêtre, je suis entrée dans le débarras à côté, où le ventilateur brasse l’air chaud, paresseusement, d’un mouvement lent et comme perpétuel. J’ai bu mon café assise dans ce fauteuil acheté dans une brocante suisse et que nous avions emporté parce qu’il était confortable et surtout parce que notre chat avait l’habitude de s’y faire les griffes, nous pensions alors prendre ce matou à Bagdad et se rappeler cela maintenant montre à quel point nous étions loin d’imaginer ce qui allait suivre, ce que nous allions connaître (j’allais écrire « ici », mais non, je suis à Amman : « Bagdad » et « ici » ne seront pour moi plus jamais synonymes), et ce fauteuil que nous avions apporté pour que notre chat s’y fasse les griffes, parce qu’il n’avait pas de valeur, pour cette même raison (son absence de valeur) nous allions l’abandonner à Bagdad puisqu’il n’était plus question maintenant de faire venir aucun de nos effets par la route : piano, livres, meubles, tout partirait par avion. Quand j’ai eu fini mon café je me suis levée, j’ai passé la tête dans la salle de bains que nous utilisions au début, celle où les robinets sont dorés, celle où je me trouvais quand j’ai entendu les déflagrations des bombes lancées contre le CICR et qui ont marqué le début du ramadan en 2003. Le cycle des saisons tourne, la sécheresse et l’humidité se succèdent : à nouveau les portes s’ouvrent toutes seules, alors qu’il y a peu on n’arrivait pas à les fermer. Le salon, moquette jonchée de chutes de cartons d’emballage. Le bureau de M., vide, propre, inhabité. Puis la journée a commencé tout de même, une journée que je n’allais pas mener à son terme, une journée dont je ne connaîtrais pas le soir, du moins le soir à Bagdad (en ce moment c’est le soir, cette heure dont je viens de parler, l’heure où à Bagdad les moustiques attaquent, mais je suis sur la terrasse de l’hôtel Hicham, j’entends d’une oreille la conversation paisible de monsieur Hicham avec deux vieux amis habitués à venir discuter le soir devant une bière servie dans de grandes chopes couvertes de buée comme j’en ai une moi-même à côté de ces feuilles où j’écris, vite et sans lever la plume, comme prise d’une boulimie d’écriture, une façon de me consoler), une journée commencée à Bagdad, un matin apparemment semblable aux autres mais dont le cours serait interrompu, comme tranché d’un coup, et tout cela m’évoquait si fort une sorte de mort, comme celle du condamné qu’on exécute à l’aube ou du malade qui ne résistera pas à cette journée-là, pas différente des autres mais venue après trop de journées déjà, si bien que c’est pendant cette journée-là qu’il meurt parce qu’il faut bien mourir, de même que notre séjour à Bagdad devait bien finir. Aram et Farida sont venus très tôt le matin pour me dire au revoir, Aram avait les yeux rouges, Farida pleurait. Selon la tradition arménienne elle a jeté de l’eau derrière nous quand la voiture a démarré, pour que je revienne saine et sauve – mais cette fois je ne reviendrais pas. Puis la route de l’aéroport, Bill au volant et Ralph à côté, tous les deux bardés de munitions, et je me disais que c’était tout de même bizarre cette impression que j’avais quand j’étais en voiture avec nos CPO, c’était une espèce de bonheur, oui je dis bien « bonheur », il faut appeler les choses par leur nom, que de me déplacer dans Bagdad avec cette insolente et chaude sensation d’être protégée, impression née de la confiance que j’ai en eux et aussi d’une sorte d’amitié au-delà de tout ce qui nous sépare, comme si c’était une chance d’être là, avec eux, dans cette ville effrayante. Et en écrivant cela j’ai bien conscience que cela peut paraître choquant, équivoque, douteux, et que le fait que je sois une femme et eux des hommes n’est sans doute pas étranger à l’affaire. Tous ces contrôles multiples, sur la route puis à l’aéroport, dans l’avion et encore en descendant d’avion à Amman, je ne les regretterai certes pas, ni les chiens qui viennent renifler les bagages, ni les fouilles. L’avion était à l’heure… mais en retard quand même pour finir, parce qu’il y avait un passager en trop. (Sur la Royal Jordanian, qui plus est avec un équipage exclusivement sud-africain (comme sur Airserv), on ne se serre pas pour faire une place à un passager excédentaire.) L’hôtesse (charmante avec son chignon de jeune fille sage et une petite mèche de duvet qui bouclait sur sa nuque) est passée dans l’allée, ne pouvant s’empêcher de rire : qui était volontaire pour descendre de l’appareil, reprendre ses bagages et attendre patiemment le prochain vol trois heures plus tard ? Tout le monde baissait le nez comme font les mauvais élèves qui ont peur d’être interrogés. Eh bien tout de même, il ne faut pas désespérer du genre humain : il s’est trouvé un jeune altruiste pour sortir. Enfin l’avion a démarré, il est allé rejoindre la piste. A pris son élan. A décollé. Et là, au moment où l’avion lancé à pleine vitesse s’est séparé du sol, moi qui n’avais jamais eu d’états d’âme au moment de quitter les endroits où j’avais vécu, quels qu’ils soient, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. L’avion est monté en spirale jusqu’à ce que je voie l’aéroport tout entier s’inscrire dans le hublot et alors, comme si c’était le signal qu’attendaient les pilotes, il s’est rétabli et a pris son vol en droite ligne.