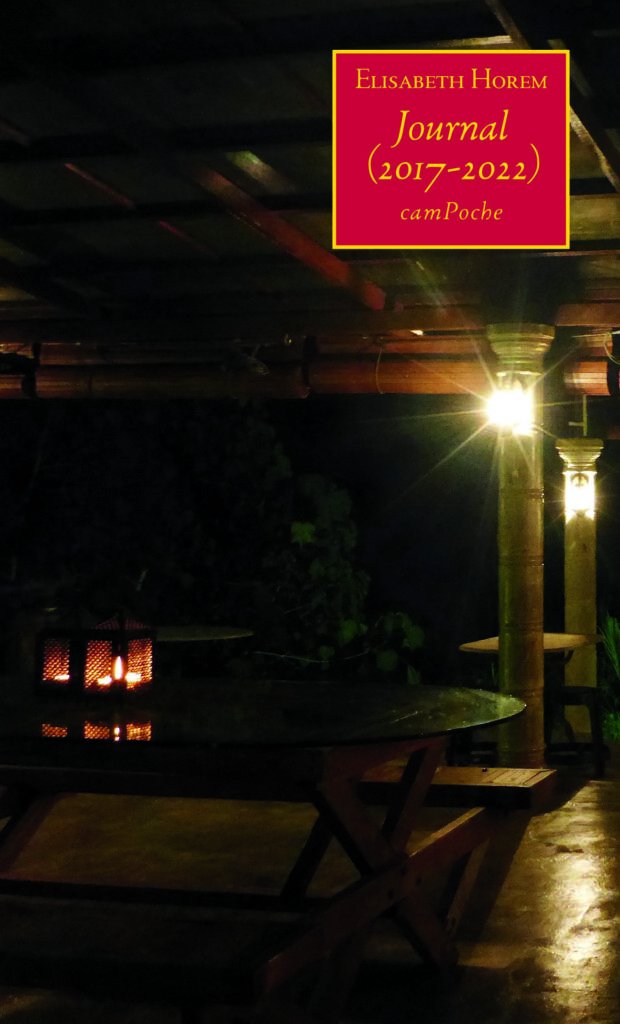À quoi a-t-il donc servi que tant de femmes se soient battues et que tant d’autres se battent encore pour que les chances soient moins inégales si c’est pour entretenir avec complaisance la distinction d’une écriture un peu à part, qui serait « féminine » ? Au moment où, les obstacles enfin surmontés, on a réussi à se mettre en route, la plume en main, vers l’œuvre à écrire, doit-on revenir en arrière et se laisser enfermer par cette catégorie d’« écriture féminine » au lieu de s’avancer librement – ce pour quoi, justement, on s’était battue ? Laissons ces classifications homme/femme où elles doivent être, c’est-à-dire dans le domaine de la politique. Elles sont caduques, il me semble, quand on entre dans celui de l’Art et des activités de l’esprit en général. Qu’est-ce qui nous pousse à écrire sinon une certaine angoisse devant ce qui nous attend, sinon le refus de nous satisfaire de l’apparence des choses ? Et ces questions-là qu’on se pose ne sont-elles pas le lot de tous, en face d’elles ne sommes-nous pas tous également démunis ? Pour ma part, je préfère suivre le conseil que Flaubert donnait à Louise Colet (qu’il a aimée, je crois, en égale) : « Laisse donc là ton sexe et ta patrie, et c’est par ce détachement que l’immense sympathie des choses et des êtres nous arrivera plus abondante ».
(Réponse à la question posée par les Editions d’en Bas pour l’anthologie Solitude surpeuplée, en 1996 : « Que recouvre pour vous l’expression écriture féminine ? »)