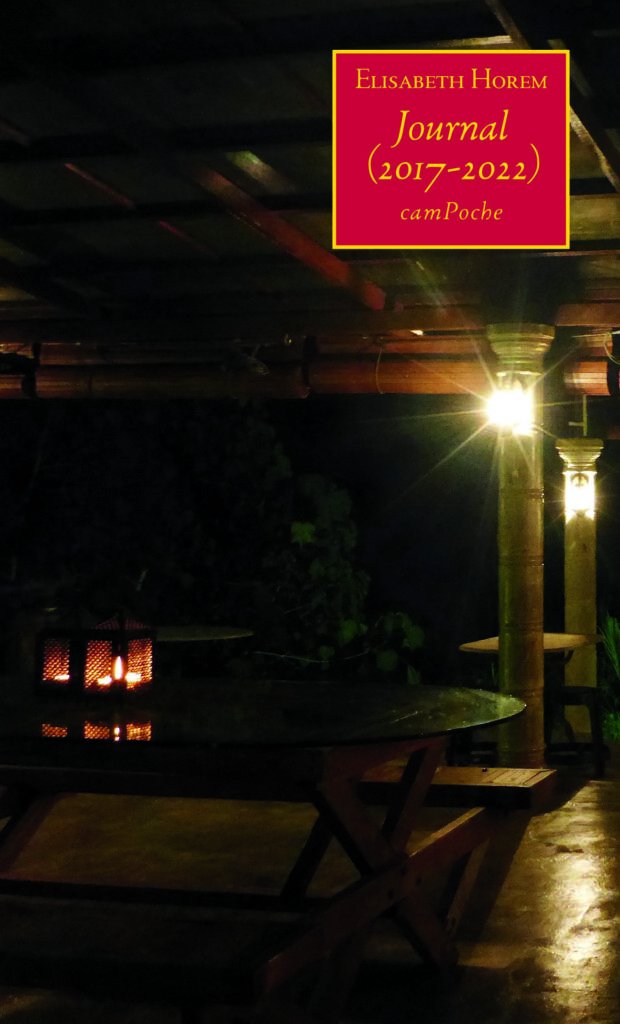(Texte en annexe à Un jardin à Bagdad)
Ce texte a été écrit en septembre 2006 d’après mon journal, pour la revue belge Balises (à paraître en automne 2007). Il fait le récit d’une excursion dans la « zone verte » à Bagdad, un vendredi d’octobre 2004. Je venais de terminer Shrapnels, qui évoque la première année de mon séjour (d’octobre 2003 à septembre 2004). J’avais été tentée d’y ajouter un chapitre qui aurait décrit cette « promenade » dans un ancien palais de Saddam détruit par les bombardements américains, mais j’y avais renoncé parce que ce livre me paraissait terminé et complet tel qu’il était. D’autre part je m’étais fixé pour sujet une année à Bagdad, ni plus, ni moins, et je voulais m’y tenir.
Dans la zone verte la nervosité était tangible à cause des attentats de la veille, mais quand ils ont voulu entrer dans ce palais détruit qu’elle avait déjà remarqué derrière une façade en grande partie intacte, seul un militaire leur a demandé ce qu’ils venaient faire là. Il ne savait trop que penser de cette femme portant comme une bannière son appareil photo monté sur pied. Pour finir il ne leur a dit ni oui ni non mais, sans conviction, de faire vite. Ils ont décidé qu’ils prendraient tout leur temps.
Ils commencent par les « souterrains », juste un sous-sol en fait, le premier sous-sol seulement car le reste est inondé, et elle se demande combien d’étages il y a encore là-dessous. Le sol ouvert par endroits laisse voir des canalisations que l’eau recouvre. Un escalier descend à l’étage inférieur, ses marches disparaissent vite dans l’eau, une eau noire où elle plonge le faisceau de sa lampe de poche : de minuscules bestioles nagent là-dans. Elle ne peut s’empêcher de se demander s’il n’y aurait pas par hasard, dans les profondeurs de ces sous-sols inondés, les corps de gens qui se seraient trouvés pris au piège, noyés pour finir. D’où peut bien venir toute cette eau ?
Ils longent des couloirs, ils passent devant des salles où il y a des générateurs, devant d’anciens bureaux pleins d’ordinateurs cassés, ils franchissent de grosses portes blindées. Il y a des compteurs électriques aux câbles sectionnés, des néons arrachés, des miroirs brisés dans des salles de bains. Il faut faire attention à ne pas glisser sur le carrelage mouillé. Une pomme de douche laisse couler de l’eau, depuis combien de temps, qui donc a pris là une douche pour la dernière fois ? Personne n’a fermé le robinet, depuis des mois peut-être cette douche continue à couler pour rien, inondant peu à peu tout autour. L’eau ruisselle, gouttant du plafond comme de la voûte d’une grotte, il flotte une odeur de cave. Ils découvrent une petite pièce où sont encore des fauteuils, une sorte de salon petit bourgeois, les coussins sont détrempés, le bois est tout gonflé d’humidité, la moquette gorgée d’eau comme une mousse où le pied s’enfonce. On entend goutter l’eau, ploc, ploc. Qui a pu s’asseoir dans les fauteuils de ce salon sans fenêtres ? Quelques fonctionnaires affairés à entretenir les rouages du régime et se reposant là, une fois terminée la besogne du jour ?
Ils prennent un autre couloir, il n’y a plus d’eau, ça sent la poussière. Elle a failli mettre le pied sur un rat mort, tout sec. Leurs torches électriques se reflètent dans un miroir à l’autre bout du couloir, faisant surgir d’autres visiteurs, leurs semblables égarés dans ces souterrains. Tout cela lui rappelle les livres qu’elle dévorait gamine, quatre enfants et un chien à qui il arrivait toutes sortes d’aventures. On marche sur du verre pilé. Il y a là un cabinet médical (c’est écrit sur la porte), toutes les vitrines ont été pulvérisées. Par terre traîne une paire de bottes faites dans une matière souple, orange, des bottes de protection contre les matières nocives, pense-t-elle. Des armoires métalliques évoquent un vestiaire de sportifs (« Vêtements propres », est-il écrit en arabe sur l’une de ces armoires). Il se dégage de cette pièce une sale impression, quelles étaient au juste les activités de ce « cabinet médical », elle trouve que ces bottes orange ont quelque chose d’inquiétant… Et pourquoi tout est-il cassé ? Par qui ? Par ceux qui sont entrés les premiers après les bombardements, s’attendant à tout et l’arme au poing, prêts à tirer sur tout ce qui bouge ? Ou bien par ceux qui tenaient la place et qui ont peut-être préféré détruire eux-mêmes ce qu’ils pouvaient, pour ne laisser aux nouveaux arrivants que des compteurs électriques aux câbles sectionnés, des néons arrachés, des miroirs brisés ? À moins que ce ne soit l’œuvre de pillards ?
À l’entrée d’une pièce, le carrelage est maculé d’une grande tache rouge. Qui était l’homme qui a saigné là ? Et pourquoi ? Où se trouve-t-il maintenant ? Est-il vivant ou mort ?
Et encore des bureaux et des bureaux, moins saccagés que le reste et où l’on voit parfois, sur un coin de table ou par terre, récentes, une bouteille d’eau entamée ou une cannette de bière trahissant la présence des nouveaux venus.
Ensuite ils sont remontés à l’intérieur du palais, l’homme qui les guidait semblait connaître les lieux par cœur, ils ont débouché au milieu d’un édifice en ruine de la taille d’une cathédrale, du toit il ne restait plus que l’armature métallique, poutrelles tordues auxquelles tenaient encore, branlants au-dessus de leur tête, des morceaux de maçonnerie, c’était comme un immense chantier de démolition, révélant sous la prétention de la décoration luxueuse, orientale (fragments de porte en bois sculpté, bouts de frise en marbre), les matériaux grossiers mis à nu : béton armé, ciment, ferraille. Des morceaux de béton sont retenus comme de gros cailloux par les tiges distordues de l’armement. Ils marchent avec précaution sur la couche de gravats. La cabine éventrée d’un ascenseur est tombée de guingois au fond d’un cratère creusé par une explosion. Il plane un silence de mort qui les a fait taire. Il suffirait d’une légère secousse sismique ou bien, plus vraisemblablement, d’un tir de roquette près de là pour que leur tombent sur la tête ces masses en équilibre. Les tentures arrachées pendent çà et là sur les poutrelles, grands pans de tissu somptueux, comme les draperies d’un décor de théâtre accrochées là-haut dans les cintres. Au milieu de ce champ de ruines il y a un gros fauteuil large et doré comme un trône, défoncé, perdant sa bourre. Il a été placé là intentionnellement, sans doute pour s’y faire prendre en photo assis, les jambes croisées et le bras impérialement posé sur l’accoudoir de bois doré, beaucoup de ces jeunes soldats étrangers ne sont pas méchants, juste un peu niais, ils aiment les images, de nos jours on peut les envoyer dans le monde entier le temps d’un clic, quelques-uns n’ont pas résisté à l’envie d’envoyer à leur petite amie certaines photos qui les perdront, ils s’étaient si bien amusés pourtant, voilà qu’on ne peut plus plaisanter… De l’autre côté, à travers l’une des immenses fenêtres une énorme lanterne pend, à moitié arrachée, se balançant doucement dans la brise… Ils sont ressortis par un autre endroit pour passer sous cette lanterne dont elle a pris une photo. (La lanterne oblique sera au centre de l’image. Sur la partie droite on verra la coupole et le plafond ornés de frises, intacts. Sur la partie gauche on verra le mur démoli, poussé vers l’extérieur par le souffle de l’explosion comme par un coup de poing monstrueux qu’un géant fou furieux aurait donné contre le mur. Du contraste entre ces deux parties, l’une intacte et l’autre dévastée, de part et d’autre de cette grande lanterne qui pend, de travers, et qui doit bien faire trois mètres de haut, naîtra l’impression d’un monde déséquilibré, insolite et désormais peu fiable.)
Ils se sont arrêtés sur le seuil d’immenses salles que des ouvriers sont en train de déblayer. Que pensent-ils, ces hommes qui balaient tous ces gravats, ce verre brisé ? Même s’ils ont détesté le dictateur déchu, ce n’en est pas moins une humiliation que de voir anéanti par une armée étrangère, et si facilement, le pouvoir qui les a longtemps fait trembler.
Après quoi ils reprennent les voitures pour aller voir ces grands sabres de bronze croisés, tenus par des mains colossales, de bronze également, les Sabres du Triomphe qu’elle n’a jamais vus que de loin. Un homme monte dans l’un des bras qu’on peut « visiter ». Elle le voit passer la tête dans une ouverture ménagée entre la main et la poignée du sabre puis ressortir peu après, trempé de sueur (la montée se fait par une échelle dans un boyau très étroit où la chaleur est terrible). À chaque bras pend un grand filet de bronze, sorte de corne d’abondance remplie d’une moisson de casques – les casques des soldats ennemis. Cette cascade de casques descend jusqu’à terre, les derniers sont à demi enterrés, toute la largeur de la chaussée est traversée par ces casques de bronze pris dans le bitume. Cela lui rappelle les passages cloutés de jadis et aussi les damnés qu’un grand illustrateur a représentés prisonniers d’une banquise refermée sur eux pour l’éternité, seuls émergent de la surface glacée le haut de leur crâne et le regard vide de qui a laissé tout espoir en entrant ici, c’est à cela qu’elle pense en les regardant, comme s’il y avait encore sous la chaussée les cadavres de ceux qui ont porté ces casques qu’on a pris soin d’enterrer à demi pour que les défilés militaires leur passent dessus, pour qu’à chaque parade soient tués encore une fois ces soldats morts dont le char calciné achève de rouiller dans quelque désert de la région. Plus de défilés désormais pour ce dictateur-là, mais puisque le lieu a été conçu pour les parades on peut y voir maintenant les véhicules d’une autre armée, des Humvee disposés en formation savante, posant ce jour-là pour une affiche de propagande, pour le calendrier des armées ou pour tout ce qu’on voudra du même genre. Ils l’ont vue prendre une photo et un soldat est venu s’assurer qu’elle ne les avait pas pris, eux. Non, elle ne les avait pas pris, seulement les Sabres qui l’intéressaient bien plus (elle pouvait d’ailleurs lui raconter n’importe quoi, il n’avait aucun moyen de vérifier et il n’allait tout de même pas lui confisquer sa pellicule).
Pour s’éloigner un peu de tous ces véhicules guerriers ils sont passés sous l’arche des sabres croisés et ils ont roulé jusqu’à l’ancienne tribune du dictateur. C’est une grande tribune maintenant couverte de poussière, elle a été conçue pour des centaines de spectateurs et près de chaque siège se dresse un gros tuyau obscène : la climatisation. Un gardien est là, qui prête un fusil aux visiteurs qui le désirent pour qu’ils puissent se faire photographier à la place de l’ancien président, brandissant leur arme comme il le faisait lors des parades. Il devrait leur fournir aussi ce chapeau qui parachevait sa panoplie de bandit en ce qu’elle mêlait l’habit civil, chapeau et pardessus, et le moyen de la violence, l’arme, haut brandie comme pour une fantasia.
Ils ont suivi le gardien à l’intérieur. Dans l’entrée le visiteur est accueilli par quelques croûtes à la gloire du dictateur représentant, par exemple, le visage de son ennemi (le père) coincé dans une bottine, tous ces tableaux d’une facture maladroite et enfantine, ce qui prouve une fois de plus qu’aucun artiste digne de ce nom ne peut servir ce genre de thème. Puis le gardien les fait entrer dans les pièces vides, vastes, silencieuses, de l’appartement du dictateur déchu – l’un de ses appartements. Celle qui avait été sa chambre à coucher est baignée d’une lumière dorée qu’atténue la couche de poussière sur les vitres. Dehors on voit une aire bétonnée d’où ne décolle désormais aucun hélicoptère. Elle reste un long moment à observer les impacts de balle qui étoilent les vitres blindées et les cassures filant dans l’épaisseur du verre, brillantes, et qui font penser à la glace quand elle se brise sur les étangs gelés, les beaux matins d’hiver.